Petit bonheur d’un moment : lire de l’écriture même de
Dumas – père – des passages de ses Mémoires,
sur de grands folios bleus de papier très mince (du papier pelure ?).
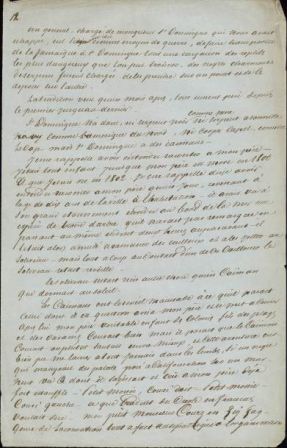 L’épisode
merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint
Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa
belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans
le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne
mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :
« les oliveau netait rien autre
chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il
d’un trait, sans ratures.
L’épisode
merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint
Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa
belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans
le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne
mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :
« les oliveau netait rien autre
chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il
d’un trait, sans ratures.
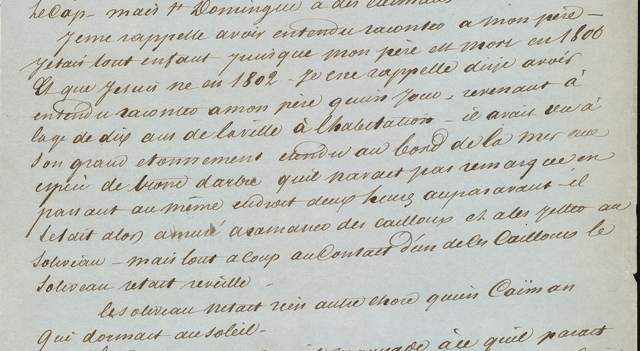
Émotion étrange, comme de se sentir un moment plus proche d’un
créateur plein de passion, d’humanité généreuse.
C’était à la maison de Dumas, à Villers-Cotterêts, sous la
conduite éclairée de Marion Renard, sa charmante jeune conservatrice, merci à elle.
Voici le texte transcrit (et dans le manuscrit, ici) :
« Saint-Domingue
n'a donc ni serpent noir comme Java, ni serpent à sonnettes comme l'Amérique du
Nord, ni cobra-cappel comme Le Cap ; mais Saint Domingue a des caïmans.
Je me rappelle avoir
entendu raconter à mon père, – j'étais bien enfant, puisque mon père est mort
en 1806 et que je suis né en 1802 –, je me rappelle, dis-je, avoir entendu
raconter à mon père qu'un jour, revenant à l'âge de dix ans de la ville à
l'habitation, il avait vu, à son grand étonnement, étendu au bord de la mer,
une espèce de tronc d'arbre qu'il n'avait pas remarqué en passant au même
endroit deux heures auparavant ; il s'était alors amusé à ramasser des cailloux
et à les jeter au soliveau ; mais tout à coup, au contact de ces cailloux, le
soliveau s'était réveillé : le soliveau n'était rien autre chose qu'un caïman qui
dormait au soleil.
Les caïmans ont le
réveil maussade, à ce qu'il paraît ; celui dont il est question avisa mon père
et se prit à courir après lui. Mon père, véritable enfant des colonies, fils
des plages et des savanes, courait bien ; mais il paraît que le caïman courait
ou plutôt sautait encore mieux que lui, et cette aventure eût bien pu me
laisser à tout jamais dans les limbes, si un nègre qui mangeait des patates,
posé à califourchon sur un mur, n'eût vu ce dont il s'agissait, et crié à mon
père, déjà fort essoufflé :
- Petit monsié, couri
droit ! petit monsié, couri gauche !
Ce qui, traduit du
créole en français, voulait dire : « Mon petit monsieur, courez en zigzag » ;
genre de locomotion tout à fait antipathique à l'organisation du caïman, qui ne
peut que courir droit devant lui, ou sauter à la manière des lézards.
Grâce à ce conseil,
mon père arriva sain et sauf à l'habitation. Mais en arrivant comme le Grec de
Marathon, il tomba hors d'haleine, et peu s'en fallut que ce ne fût, comme lui,
pour ne plus se relever.
Cette course, dans
laquelle l'animal était le chasseur et l'homme le chassé, avait laissé une
profonde impression dans l'esprit de mon père. » (Mes Mémoires, chapitre
II)
Et voici les
Mémoires,
en volumes brochés, et dans la belle édition reliée rouge (moi, j’ai la verte)
chez A. Le Vasseur
et Cie, 33, rue de
Fleurus, 33. Avec le portrait de Dumas dodu, sa plume à la main devant son écritoire,
incrusté dans la toile de la couverture.
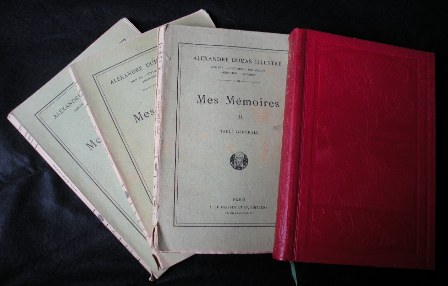
Lecteur, si tu passes par Villers-Cotterêts, n'oublie pas d'aller saluer Dumas en sa
maison.
 En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer que je ne connaissais pas, et qui ne m’inspirait
guère a priori, je suis tombée sur ce
passage, et l’idée m’a illuminée qu’il y avait là une source des Liaisons Dangereuses. Que cette citation
aurait été aussi légitime à l’orée du roman que la phrase de Rousseau extraite
de La Nouvelle Héloïse qui y
figure : « J’ai vu les mœurs
de mon temps, et j’ai publié ces lettres ». Comme si dans la forme du
roman épistolaire, auquel il donne une sorte de perfection, Laclos répondait à
travers le temps à l’injonction du poème d’Ovide.
En traduisant il y a deux ans L’Art d’aimer que je ne connaissais pas, et qui ne m’inspirait
guère a priori, je suis tombée sur ce
passage, et l’idée m’a illuminée qu’il y avait là une source des Liaisons Dangereuses. Que cette citation
aurait été aussi légitime à l’orée du roman que la phrase de Rousseau extraite
de La Nouvelle Héloïse qui y
figure : « J’ai vu les mœurs
de mon temps, et j’ai publié ces lettres ». Comme si dans la forme du
roman épistolaire, auquel il donne une sorte de perfection, Laclos répondait à
travers le temps à l’injonction du poème d’Ovide.
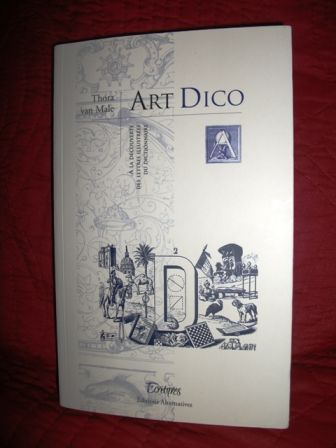
 Intitulée L’Aiguille, c’est un hommage à Cendrars
dont la trogne et la manche vide sont bellement burinés en noir et blanc sur la
couverture. Je n’ai pas lu Le Plan de
l’aiguille, vers quoi s’oriente ma boussole de lectrice. J’ai laissé L’Aiguille à la maison, fragile. Et il
est bon que les vagabondages créatifs s’attachent aux pas de Blaise, qui a,
somme toute, bon nombre de lecteurs passionnés.
Intitulée L’Aiguille, c’est un hommage à Cendrars
dont la trogne et la manche vide sont bellement burinés en noir et blanc sur la
couverture. Je n’ai pas lu Le Plan de
l’aiguille, vers quoi s’oriente ma boussole de lectrice. J’ai laissé L’Aiguille à la maison, fragile. Et il
est bon que les vagabondages créatifs s’attachent aux pas de Blaise, qui a,
somme toute, bon nombre de lecteurs passionnés. 
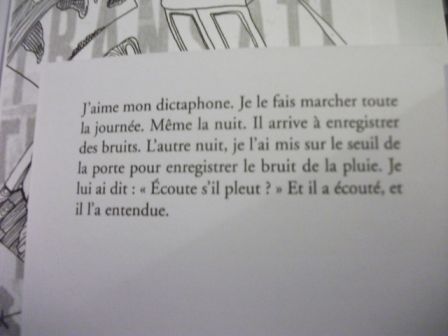

 Rêve
d’amour
Rêve
d’amour
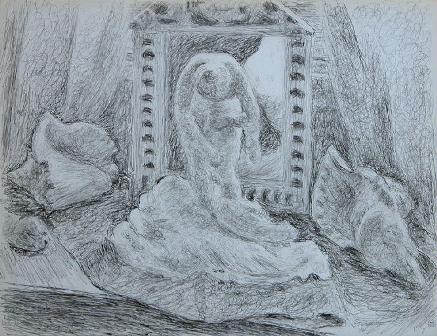




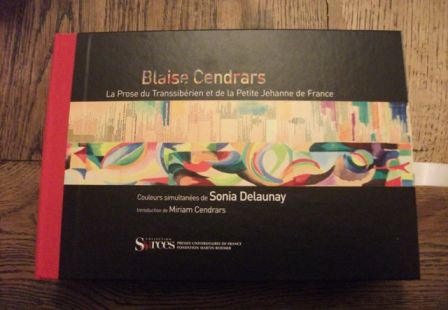
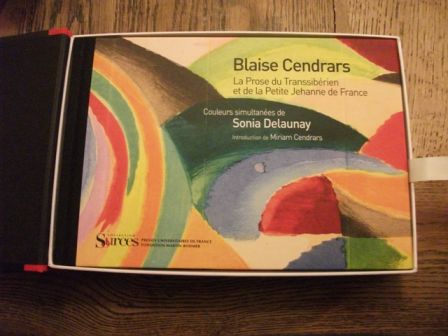

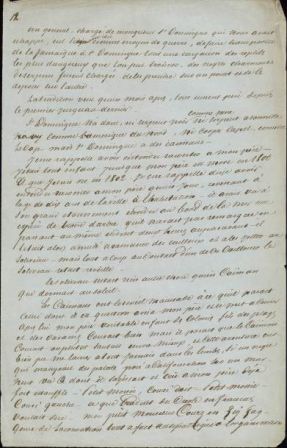 L’épisode
merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint
Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa
belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans
le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne
mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :
« les oliveau netait rien autre
chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il
d’un trait, sans ratures.
L’épisode
merveilleux de son père poursuivi par un caïman, sur une plage de Saint
Domingue, par exemple. Et de découvrir que Dumas le calligraphe - c’est à sa
belle écriture et à ses talents de copiste qu’il a dû de se trouver engagé dans
le bureau du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe – que Dumas le calligraphe ne
mettait aucun accent, aucune apostrophe, et coupait étrangement ses mots :
« les oliveau netait rien autre
chose quun caïman qui dormait au soleil » (folio 12). Grands folios écrits semble-t-il
d’un trait, sans ratures.